Jeudi 18 avril 2024, 4:14 | Dernière mise à jour : 22 heures et 15 minutes

Des anciens d'Indochine veulent sauver la mémoire de leur camp
Société
Des anciens d'Indochine veulent sauver la mémoire de leur camp

(La Croix) - Devenu insalubre et dangereux, le Centre d’accueil des Français d’Indochine (Cafi) de Sainte-Livrade-sur-Lot, en Lot-et-Garonne, va laisser place à des HLM.
Des dizaines de baraquements en béton surmontés d’un frêle toit de fibrociment regorgeant d’amiante ; une électricité hors norme ; des murs non isolés ; des canalisations d’eau qui explosent avec le gel… Quand on entre dans le Centre d’accueil des Français d’Indochine (Cafi) de Sainte-Livrade-sur-Lot, on a peine à croire que des gens vivent encore ici.
Construit à la hâte dans les années 1950, cet ancien camp militaire était destiné à accueillir provisoirement les rapatriés d’Indochine après le retrait de la France du sud du Vietnam en 1954 (1). Au total, 1 160 réfugiés, dont 740 enfants, couples mixtes, veuves de Français fuyant la guerre et le communisme, ont débarqué dans cette commune rurale. « Je suis arrivé avec mes six frères et sœurs, une valise en carton à la main », se souvient Ariffe, 68 ans, un adjudant à la retraite.
Mais le provisoire a duré. Sainte-Livrade est devenu le « camp des oubliés ». Oublié par l’État, qui en assurait la gestion jusque dans les années 1980, avant que la commune ne rachète ce terrain de sept hectares. « Regardez, nous avons dû installer nous-mêmes des toilettes, une douche dans nos maisons », fustige Jean-Claude Rogliano, 68 ans, un « enfant du camp ».
120 foyers habitent encore au Cafi
« Je me demande comment on a pu les laisser dans des conditions aussi indignes pendant cinquante-quatre ans », se révolte Claire Pasut, maire PS de la commune, élue depuis deux ans. « On était tellement heureux d’être en vie que l’on n’a rien osé demander », tente d’expliquer Ariffe, qui est revenu au camp pour aider sa mère et d’autres personnes âgées dans leur quotidien.
Sur la cabine téléphonique des lieux, un message qui en dit long : « Vietnam-sur-Lot, la vie, c’est dur, mais on s’en remet. » Étrangement, pourtant, les rapatriés n’affichent pas de rancœur. « La France nous a menti, mais je n’ai pas de haine », assure Tony, 64 ans, un ancien légionnaire. C’est l’émotion qui prime. « J’ai vécu toute mon enfance ici. On ne sortait pas du camp, on avait tout, l’école, le terrain de foot, l’église, la pagode, le médecin… c’était bien », raconte André Forget, 47 ans, aujourd’hui conseiller municipal d’opposition (Nouveau Centre), qui réside désormais en ville.
Actuellement, seuls 120 foyers habitent encore au Cafi. La plupart sont des personnes âgées, des jeunes en grande précarité et des handicapés mentaux. Les autres ont trouvé du travail et ont quitté l’endroit pour Paris, Toulouse ou Bordeaux.
« C’est vécu comme un deuxième déracinement »
Pour ceux qui sont restés, la vie va radicalement changer. Tout doit en effet être démoli. Des HLM flambant neufs vont remplacer les baraques décaties. La première pierre du nouvel ensemble a été posée le 28 mai. Trente-deux appartements seront prêts d’ici à la fin de l’année. Au total, 120 logements seront construits à l’horizon 2013. Des travaux financés par l’État à hauteur de 6,5 millions d’euros, par la commune (4,7 millions), ainsi que par le conseil général et le conseil régional d’Aquitaine.
Pourtant, ce changement suscite plus de craintes que de joie. « Les mamies auront de petits T2. Où vont-elles mettre tous leurs meubles ? Elles ne pourront plus accueillir chez elles leurs enfants et petits-enfants, ce qui va accroître leur isolement », s’inquiète André Forget. Mais surtout, pour nombre d’habitants, cette opération arrive trop tard. « Il fallait le faire il y a vingt-cinq ans. J’ai 97 ans, où voulez-vous que j’aille ? », demande Jacqueline Le Crenn, dont le père est mort à la guerre de 1914-1918, « pour la France ».
« C’est vécu comme un deuxième déracinement », explique André Gontran, 45 ans, l’un des deux épiciers du camp. « On ne nous donne pas le choix », soupire Simone, 83 ans. Pourtant, « on a travaillé dur dans les champs de haricots ou dans les usines », se souvient cette mère de huit enfants qui vit seule, avec 570 € par mois. Depuis vingt-cinq ans, cette fervente bouddhiste tient la pagode du camp. « Un lieu de culte exceptionnel », fait remarquer Martine Pôleth Wadbled, ethnologue, qui travaille ici depuis une quinzaine d’années. « Les habitants ont organisé le culte des quatre génies avec les moyens du bord, à leur manière. »
Les familles réclament que l’on reconnaisse leur souffrance
C’est toute cette mémoire qui risque aujourd’hui de disparaître. « Si l’on détruit nos habitations, dans vingt ans, plus personne ne se souviendra que l’on a vécu ici. Je veux que mes petits-enfants connaissent l’histoire de leurs grand-père et arrière-grand-père », s’inquiète Jean-Claude Rogliano.
Une histoire douloureuse. Jusqu’aux années 1970, le camp était grillagé, entouré de barbelés, dirigé par d’anciens administrateurs des colonies. En 1959, il était interdit d’en sortir sans autorisation. Un arrêté avait même instauré un couvre-feu à 22 heures. « C’était un régime militaire, cruel », s’indigne Matthieu Samel, cinéaste né dans le camp en 1958 et qui vit aujourd’hui dans les environs. « Peut-être que la France a honte de la façon dont elle nous a accueillis et veut faire table rase de ce passé », poursuit Jean-Claude.
Aujourd’hui, les familles réclament que l’on reconnaisse au moins leur souffrance. Pour Jean-Claude Rogliano, il faut au minimum conserver l’église, la pagode, un quartier « témoin » et créer un musée avec des objets d’Indochine. « L’État français a une grande dette envers nous. Il nous doit bien ça. » « On garde bien les tranchées de Verdun », rappelle Émile Lejeune, 89 ans, un ancien adjudant, fils de la princesse vietnamienne Annam, qui veut mourir au Cafi, comme sa mère.
Un bureau d’étude girondin, dirigé par le sociologue Daniel Mandouze, va collaborer avec les habitants du Cafi pour tenter de préserver la mémoire de ce lieu. Au cas où leur volonté ne serait pas respectée, chacun, à l’image d’Isabelle, 61 ans, qui est revenue vivre sa retraite au camp, prend des photos pour garder une trace.
Nicolas CÉSAR
(www.la-croix.com - 08/06/2010)
(1) En France, il n’existe plus que deux camps de rapatriés d’Indochine. L’autre se situe à Noyant (Allier).
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires















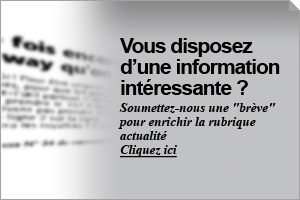






Articles les plus commentés
Hanoi lutte contre les arnaques ciblant les touristes étrangers (20)
1.
Le marché «à la française» de Hanoi (20)
2.
Un resto à 2.000 Dongs (0.08 euro) défiant toute concurrence: est ce possible? (9)
3.
Vietnam: Le camping à la plage, une nouveauté à découvrir (8)
4.
Le Visa Vietnam de nouveau obligatoire dès le premier jour de séjour (7)
5.
Nestlé: inauguration d'une usine Nescafé au Vietnam (6)
6.
Vietnam Airlines face aux compagnies du golfe (6)
7.
Mer Orientale : la diaspora vietnamienne mobilisée pour le pays (4)
8.
Un Français enseigne les arts martiaux aux enfants handicapés (4)
9.
Chuc mung nam moi, Bonne année (4)
10.